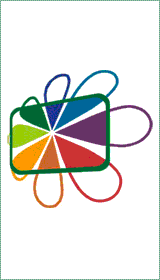A l'aube du développement des transports
Du portage humain au chameau
Le moyen de transport terrestre le plus ancien est sans doute le portage humain. Par la suite l'homme a aussi utilisé les animaux pour l'aider : le bœuf, domestiqué dès le Ve millénaire av. J.-C., sera utilisé pour tirer des charges. L'âne domestiqué au IVe millénaire av. J.-C., servira à tirer et à porter des charges ou des personnes. Le cheval, animal de luxe au IIe millénaire av. J.-C., sera plus couramment utilisé par la suite.
Quant au chameau, il n'apparaît pas avant le Ie millénaire av. J.-C. Les charges pouvaient être tirées sur un traîneau, comme le montrent des dessins et des signes pictographiques. L'utilisation de la roue a permis, au IIIe millénaire av. J.-C. en Mésopotamie, de tirer des charges beaucoup plus lourdes. Le transport par voie d'eau est aussi très ancien.
La roue
La roue était connue ailleurs qu'en Mésopotamie, mais les Mésopotamiens sont parmi les premiers à en avoir fait un usage systématique. Des maquettes et différentes représentations montrent des chariots à quatre roues pleines, sans doute très pesants et peu maniables, utilisés à des fins civiles ou militaires, mais aussi des chars plus légers à deux roues. Les premières roues étaient faites de deux demi-cercles en bois plein attachés ensemble, cerclées de métal ou renforcées de clous. Les roues à rayons apparaissent au 2 e millénaire av. J.-C. Des petites roues en argile, sans doute restes de maquettes de char, objets votifs ou jouets, sont retrouvées en grande quantité sur les chantiers de fouille.
La navigation
Des embarcations sont représentées sur les sceaux-cylindres, les bas reliefs, ou sous forme de maquettes : bateaux en roseau ou en bois manœuvrés à la rame ou à la gaffe, avec souvent, en Mésopotamie, la proue et la poupe relevées. On utilisait aussi de simples radeaux de troncs d'arbre, parfois stabilisés par des outres gonflées. Certains bateaux pouvaient transporter des cargaisons de plusieurs tonnes. La navigation sur les fleuves était difficile, à cause des méandres et des courants, et les Mésopotamiens ont creusé des canaux permettant de raccourcir les distances et de naviguer en toute sécurité. La navigation dans le Golfe Arabo-persique ou en Méditerranée devait nécessiter d'autres types d'embarcations, comme celles qui sont représentées sur les bas reliefs égyptiens.
Les routes
Les grandes routes de l'époque (par exempe la Route de la soie) ne nous sont pas connues par des cartes, mais par des itinéraires où l'auteur du texte donne la liste des étapes avec, parfois, le temps de trajet qui les sépare. Il devait s'agir généralement de routes de terre, sans préparation ni entretien particulier, sauf sur de très courts tronçons, empierrés ou asphaltés, utilisés pour des processions religieuses. Elles étaient souvent coupées par les pluies et l'usure due à la fréquentation, mais certaines étaient assez spacieuses et carrossables pour permettre le passage de chars rapides qui pouvaient faire une moyenne d'une centaine de kilomètres par jour. Les ponts les plus simples étaient en troncs d'arbres, mais pour de longues portées, on pouvait utiliser des ponts de bateaux ou des ouvrages en pierre. La sécurité des voyageurs n'était pas toujours bien assurée, et ils préféraient voyager en caravanes.
Le développement des Routes
Les premières voies de communication terrestres furent, à n'en pas douter, de simples sentiers, péniblement frayés à travers les immenses forêts qui couvraient le sol. Pendant longtemps, et pour certaines régions jusqu'au XIXe siècle, les transports des biens et des personnes furent surtout fluviaux ou maritimes.
Les routes de l'Antiquité
De véritables routes, accessibles aux plus lourds charrois et reliant directement les principales agglomérations, apparaissent progressivement àl'Antiquité.
Moïse fait mention dans l'Ancien Testament d'une «voie royale» aboutissant à la capitale des Amorrites ; en Egypte, le pharaon Khéops en fit construire une qui, d'après le témoignaged'Hérodote, occupa 100'000 hommes pendant dix années. Les Perses et les Babyloniensconstruisirent également des routes magnifiques : à partir du VIe siècle av. J.-C., ils relièrent entre elles les routes existantes pour former la voie royale d'Ephèse à Suse, près du golfe Persique.
Mais, dès le XXe siècle avant notre ère, Babylone était déjà reliée à Suse, à Ecbatane et à Sardes. Les Carthaginois pavèrent les leurs, ce qui constituait une innovation. En Grèce, comme partout ailleurs, le passage fréquent des hommes et des animaux sur des tracés déterminés par le relief du terrain, la végétation et les points d'eau donna naissance à des pistes, qui ne devinrent des routes que lorsque «le travail des mains s'ajouta à celui des pieds» pour les régulariser, rendre le sol plus résistant, faciliter l'écoulement latéral des eaux de pluie et le passage des torrents, adoucir les montées et les descentes trop abruptes.
Les routes grecques
Aux époques minoenne et mycénienne (2500-1000 av. J.-C.), il existait déjà en Grèce des tronçons de routes et des rues pavés. Ainsi, une route pavée, bordée de magasins, conduisait au palais de Cnossos et aboutissait à une place carrée, garnie de sièges sur deux côtés. Une rampe large de 8 mètres, soutenue par un puissant mur, pavée de grandes dalles irrégulières, subsiste au sud-ouest de l'enceinte de Troie.
A l'époque classique
Les Grecs n'ont jamais su construire des viaducs au-dessus des vallées, ni gravir les montagnes par des routes en lacets. Quelques routes carrossables, comme celle qui reliait Athènes au Pirée, répondaient sans doute à un intérêt commercial ; mais elles n'étaient de bonne qualité que sur des tronçons assez courts, établis pour faciliter les pèlerinages et les processions religieuses, comme la voie sacrée d'Athènes à Eleusis. Les plus fréquentes traces des travaux exécutés par les Grecs sont des «ornières artificielles», profondes de quelques centimètres, qui avaient pour but de rendre moins dangereux le passage des chars sur des roches affleurantes. En cas de voie unique, et pour remédier à l'inconvénient des rencontres de chars, on prévoyait, de place en place, des voies d'évitement.
Les routes romaines
C'est aux Romains, bâtisseurs infatigables, que nous devons le mot «route»: la construction d'une voie (via) supposait la «rupture» des obstacles qui se présentaient, d'où le nom via rupta ou, par abréviation, rupta.
Plusieurs catégories de routes
Les voies romaines, dont la largeur minimale était fixée par la loi des Douze Tables (8 pieds pour un tracé en ligne droite, 16 pieds dans les parties courbes), étaient classées en viae publicae, vicinales et privatae. Les premières, incluant les rues des villes, étaient établies sur un sol appartenant au domaine public et appelées viae regiae, consulares ou praetoriae suivant la qualité des magistrats qui les avaient construites. Les deuxièmes reliaient des routes plus importantes ou des bourgades rurales ; les dernières étaient créées, et entretenues, par des particuliers propriétaires du sol.
Les routes se développent avec le commerce
Le réseau primitif, reliant Rome aux cités voisines, s'étendit à mesure que les relations commerciales se développaient et que la conquête progressait. Pour les premiers siècles de la République, l'historien Tite-Live mentionne la via Gabina, la via Latina, qui allait de Rome en Campanie, et la via Salaria, par laquelle le sel des marais d'Ostie était transporté vers le pays des Sabins. La première voie pavée fut la via Appia, oeuvre d'Appius Claudius Caecus, reliant Rome à Capoue ; elle fut ultérieurement prolongée jusqu'à Tarente et Brindisi.
Magistrats et empereurs améliorent le réseau
Jusqu'au début du IIe siècle av. J.-C., la construction des voies répondait à des besoins stratégiques : par l'itinéraire le plus direct, elles reliaient Rome aux colonies militaires qui jalonnaient les étapes des Romains de la péninsule. A l'époque républicaine, le tribun Gracchus fut certainement l'un des hommes qui contribuèrent le plus à l'élaboration du réseau routier ; il fit notamment disposer sur le bord des routes, tous les mille pas (1 480 m.), des milliaires, colonnes portant des indications de distances. En général, les empereurs romains apportèrent un soin extrême à l'amélioration du réseau routier que la République leur léguait. A la fin du IIe siècle, il existait dans l'Empire 372 grandes voies, s'étendant sur une longueur totale de 77’000 km : 29 d'entre elles partaient de Rome et avaient pour origine le «milliaire doré» qu'Auguste avait fait placer au centre de la place du Marché.
Les principes de construction
Sur le plan technique, on distinguait trois sortes de routes : les viae terrenae, qui n'étaient que des pistes de terre battue et nivelée, les viae glarea stratae, dont la chaussée était recouverte de graviers pilés, et les viae silice stratae, pavées de dalles de pierre. Les Romains excellèrent dans la construction de ces deux derniers types de voies et mirent au point des techniques très avancées en respectant deux principes toujours valables :
- - s'adapter du mieux possible aux conditions locales ;
- - mettre les routes à l'abri des infiltrations en alternant les couches de matériaux différents, en construisant une infrastructure compacte, en bombant les surfaces pour faciliter l'écoulement des eaux vers de petits fossés parallèles à la voie (sulci).
Relais et auberges
En dehors des villes ou des villages qu'elles desservaient, le parcours des voies romaines était jalonné de deux sortes de «stations» destinées à permettre aux voyageurs de s'arrêter et de se reposer : on rencontrait les mansiones, des sortes d'auberges, tous les 45 à 60 km ; entre ces mansiones, tous les 15 à 18 km, les mutationes (simples relais pour changer les équipages).
Des travaux de grande envergure
Les voies romaines étaient tracées, autant que possible, en ligne droite ; elles évitaient le fond des vallées, car l'on redoutait l'action destructrice des infiltrations et des inondations, et passaient de préférence à mi-côte. Dans certains cas, on n'hésitait pas à creuser des tunnels ; celui qui passe sous le mont Grillo, construit sur l'ordre d'Agrippa entre Baïes et Cumes, était long de plus de 1 km, et la lumière y pénétrait par des puits.
La limitation des charges
Les routes romaines présentaient parfois des rampes fort abruptes, la pente pouvant atteindre jusqu'à 20 % d'inclinaison, ce qui avait conduit à limiter la charge des véhicules (200 livres pour une voiture à deux roues traînée par trois mules, 1000 livres pour une voiture à quatre roues traînée par huit ou dix mules) ; ces limitations étaient également liées à la conception de l'attelage antique. Ce n'est qu'au XIe siècle qu'apparut le collier d'épaule, qui allait permettre à deux chevaux de tirer une charge de 7 tonnes.